Vous êtes propriétaire d’une maison et envisagez d’installer des panneaux solaires ? Deux modèles économiques s’offrent à vous : la revente totale de votre production solaire à un fournisseur d’électricité, ou l’autoconsommation (consommer votre électricité et vendre seulement l’excédent).
Chacune de ces options a ses principes, son cadre réglementaire et un niveau de rentabilité qui lui est propre. Il est aussi primordial de s’informer, car ces derniers mois les règles ont beaucoup évolué : baisse progressive des tarifs de rachat, révision des primes à l’autoconsommation, sans oublier une TVA réduite annoncée pour le solaire en octobre prochain.
Dans cet article, nous allons comparer en détail la revente totale et l’autoconsommation, en expliquant clairement leur fonctionnement, les évolutions récentes (réglementation, coûts) et les avantages/inconvénients de chaque solution. Nous vous conseillons de faire simuler votre projet par un professionnel, car rien ne vaut une étude sur mesure pour évaluer les coûts et bénéfices selon la situation de votre foyer.
Revente totale vs autoconsommation
Revente totale de la production solaire

Opter pour une installation en revente totale veux dire que 100 % de l’électricité produite par vos panneaux photovoltaïques est injectée sur le réseau et vendue à un fournisseur agrée (EDF OA ou toute autre régie en fonction de votre localité). Vous ne consommez donc pas directement votre production et chaque kilowattheure (kWh) solaire produit est revendu selon un tarif contractuel d’Obligation d’Achat (OA) garanti sur 20 ans par l’État.
Vous continuez à payer vos consommations d’électricité normales au tarif du réseau et en parallèle vous percevez des revenus pour toute l’électricité solaire que vous vendez.
En France, le contrat OA (généralement conclu avec EDF Obligation d’Achat) assure une visibilité financière à long terme : le tarif d’achat est fixé à la signature et indexé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) chaque trimestre pour les nouvelles installations.
Les derniers tarifs de revente totale connus, qui varient selon la puissance des installations, s’appliquant à partir du 1er octobre 2025, sont les suivants :
- 0 €/kWh (> 0 et ≤ 9 kWc) ;
- 0,10 €/kWh (> 9 et ≤ 36 kWc) ;
- 0,09 €/kWh (> 36 et ≤ 100 kWc) ;
À noter que si vous choisissez une installation en revente totale, vous n’êtes pas éligible à la prime à l’autoconsommation versée par l’État, car cette prime étant réservée aux installations consommant leur production.
La revente totale convient bien aux situations où le producteur n’a pas (ou peu) d’usage de l’énergie produite par ses panneaux – typiquement une maison secondaire inoccupée en journée, un terrain agricole ou un bâtiment dont on souhaite rentabiliser la toiture inutilisée.
Autoconsommation (avec vente du surplus)

L’autoconsommation photovoltaïque désigne le fait de consommer soi-même l’énergie produite par ses panneaux solaires, pour couvrir ses besoins, plutôt que de la vendre intégralement. Votre installation est branchée sur votre tableau électrique domestique, utilisant en priorité l’énergie solaire produite pour alimenter vos appareils.
Si à un instant T votre production dépasse votre consommation, le surplus est injecté sur le réseau public. On parle alors d’autoconsommation avec vente du surplus (car ce surplus peut être cédé à un fournisseur). Dans le cas où vous consommeriez toute votre production en temps réel, il n’y aurait simplement pas d’injection (on parle d’autoconsommation totale, mais en l’absence de batteries et d’un mode de consommation adapté c’est rare, voire quasiment impossible d’y parvenir à 100 % sur l’année).
En optant pour l’autoconsommation, vous signez aussi un contrat de rachat pour l’énergie excédentaire avec EDF OA (ou un autre acheteur).
Ce contrat de vente de l’énergie excédentaire est, lui aussi, garanti 20 ans, mais porte sur un volume variable (seulement ce que vous n’avez pas consommé vous-même). L’électricité autoconsommée, elle, vous fait économiser l’achat du kWh au tarif réseau. Ça a donc un double bénéfice : des économies sur votre facture d’électricité + un revenu pour le surplus transmis.
L’État encourage fortement ce mode de consommation durable via une prime à l’investissement (dite prime à l’autoconsommation) versée pour les installations ≤ 100 kWc qui consomment leur production. Pour en bénéficier, l’installation dont la puissance doit être bien choisie, doit être réalisée par un professionnel certifié RGE et injecter le surplus dans le réseau via un contrat OA. Nous avons rédigé un article complet à son sujet si ça vous intéresse d’en savoir plus.
Pour résumer, l’autoconsommation photovoltaïque vous rend en partie producteur et consommateur de votre propre énergie : vous utilisez directement une énergie verte produite chez vous, et vendez le reste.
Évolution du cadre réglementaire en 2025
Le secteur photovoltaïque résidentiel est encadré par des dispositifs de soutien (tarifs d’achat, primes) qui ont beaucoup évolué ces dernières années, et surtout en début d’année 2025. Ces changements concernent principalement les tarifs d’achat, les primes à l’autoconsommation, et une réforme de la TVA qui interviendra plus tard dans l’année (octobre 2025).
Il est crucial d’en avoir conscience, car ça impactera directement la distribution de votre énergie produite et la rentabilité de votre projet en revente totale comme en autoconsommation.
Faisons le point sur les changements récents.
Nouveaux tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque
Précédemment fixés à 0,4 €/kWh, le nouveau tarif reste le même pour les installations de puissance ≤ 9 kWc à partir du 1er octobre 2025.
Baisse des primes à l’autoconsommation
L’année 2025 a également été marquée par de nouvelles baisses des primes à l’autoconsommation par rapport aux périodes précédentes.
Pour les installations ≤ 9 kWc, la prime est de 80 €/kWc, soit 240 € pour une installation de 3 kWc, contre 220 €/kWc (soit 660 €) entre novembre 2024 et janvier 2025, et 260 €/kWc à l’été 2024.
Cette réduction des primes, alignée sur la puissance installée, s’inscrit dans la logique de diminution progressive des aides publiques à mesure que la filière gagne en maturité et que le prix d’une installation devient plus accessible.
Réforme de la TVA pour les installations photovoltaïques
L’une des évolutions majeures pour le secteur photovoltaïque résidentiel en 2025 concerne la TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit un abaissement significatif du taux de TVA à 5,5% pour l’installation de panneaux solaires sur l’ensemble du segment résidentiel (0-9 kWc) à partir du 1er octobre 2025, soit le même taux ultra-réduit que celui applicable aux travaux de rénovation énergétique.
Cette mesure représente une avancée importante pour le secteur, car elle permet de supprimer l’effet de seuil lié à la barrière fiscale des 3 kWc actuellement en vigueur qui incitait certains particuliers à opter pour des centrales sous-dimmensionnées par rapport à leurs réels besoins de prodution.
Elle pourrait aussi compenser les éventuelles pertes de rentabilité de votre installation solaire dues aux révisions des deux autres dispositifs précédemment cités. Cette TVA à 5,5% pourrait être réservée aux panneaux d’origine européenne, ce qui constituerait une mesure de soutien à l’industrie photovoltaïque européenne face à la concurrence internationale.
Dois-je reporter mon projet photovoltaïque ?
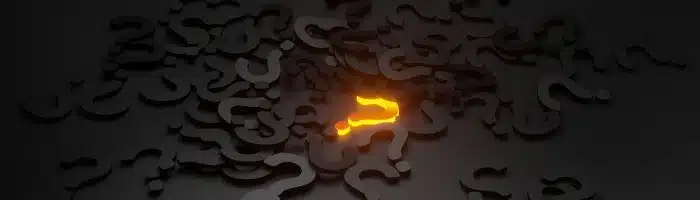
Concrètement, pour un particulier, patienter jusqu’à fin 2025 permettra d’économiser la différence de TVA sur son devis solaire. Par exemple, un 6 kWc produisant une certaine quantité d’énergie solaire à 8 200 € HT serait facturé ~ 8 659 € TTC au lieu de ~9 840 € une fois la TVA à 5,5% en vigueur, soit 1 180 € d’économies.
C’est loin d’être négligeable surtout quand on considère l’impact financier global de votre installation solaire. Cependant, attention à ne pas “mettre en pause” tous les projets dans l’intervalle : d’une part, d’ici 2025 les autres aides liées à la production d’énergie et aux nouvelles installations (prime, tarifs) continueront de diminuer (voir même de disparaitre), et d’autre part une trop forte attente pourrait saturer les installateurs à l’échéance et votre projet d’exploitation d’énergie solaire n’en serait que reporté.
Donc, si votre projet est déjà mûr, le réaliser en 2024 avec TVA 10 % (≤3 kWc) ou 20 % (>3 kWc) n’est pas forcément une “perte” : il bénéficiera encore de primes et de revenus de rachat immédiats.
La TVA à 5,5% est donc une excellente nouvelle pour les futurs autoconsommateurs (notamment pour des puissances 6 à 9 kWc qui n’avaient aucun taux réduit jusqu’ici), mais ce n’est qu’un volet parmi d’autres dans l’équation de rentabilité. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un installateur professionnel pour demander votre étude personnalisée.
Évolution des coûts et rentabilité
Outre les aides et tarifs réglementés, la rentabilité d’un projet photovoltaïque dépend bien sûr de deux grands facteurs économiques : le prix de l’installation (dépense initiale) et les économies/gains réalisés chaque année (recettes ou économies sur facture).
Ces deux dernières années ont été marquées par des fluctuations importantes : hausse du tarifs des matières premières, inflation, mais aussi envolée du prix de l’électricité réseau. Quel a été l’impact sur le solaire, et laquelle des deux options (vente totale ou autoconsommation) en sort gagnante financièrement ?
Coût des panneaux solaires : légère baisse puis nouvelle hausse
Nous l’avons évoqué dernièrement, après une baisse, les prix des panneaux solaires repartent à la hausse en ce début d’année.
Quels retours sur investissement espérer ?
La rentabilité d’un projet PV se mesure généralement par le temps de retour sur investissement, c’est-à-dire le nombre d’années nécessaires pour que les économies + revenus cumulent la somme investie de départ. Cette rentabilité dépendra fortement de l’option choisie (vente totale ou autoconsommation) et de votre profil de consommation.
Faisons un rapide comparatif pour une installation chez un particulier :
Revente totale
Ici, vos revenus annuels = production annuelle (kWh) × tarif d’achat (€/kWh).
Prenons un cas concret : une installation de 3 kWc en France produit environ 3 600 kWh par an (moyenne sur la France, plus au sud, un peu moins au nord). Avec un tarif OA autour de 0,13 €/kWh en ce moment, ça génère environ 470 € par an de revenus bruts.
Sans prime à l’investissement ni économies de facture, si l’installation vous a coûté ~5 500 €, le retour sur investissement se situerait autour de 11 à 12 ans dans cet exemple.
Autoconsommation avec surplus
Dans ce cas, vos gains annuels combinent économies sur la facture d’électricité + revenu du surplus. Reprenons l’exemple de 3 kWc produisant 3 600 kWh/an. Si votre foyer consomme 40 % de cette énergie, soit 1 440 kWh, c’est ça de moins à acheter au fournisseur : à un tarif moyen de 0,21 €/kWh, ça représente environ 300 € d’économies sur l’année.
Les 60 % restants (2 160 kWh) sont vendus à ~0,04 €/kWh, apportant environ 86 € de revenu. Au total, 386 € de bénéfice annuel.
De plus, vous touchez la prime à l’autoconsommation : 240 € pour une installation de 3 kWc (80 €/kWc) depuis le 27 mars 2025. Elle permet de réduire légèrement votre dépense initiale.
Si le coût est de 5 500 € – 240 € = 5 260 €, le retour sur investissement s’établit autour de 10 à 12 ans dans ce scénario.
Et ce calcul est prudent : le prix de l’électricité augmentant en moyenne entre 5 et 10% par an, vous pourriez rembourser une installation de 3 kWc en 8 à 9 ans seulement, là où il aurait fallu 10 à 12 ans auparavant.
De façon réaliste, on constate aujourd’hui un seuil de rentabilité de 8 ans pour des installations bien dimensionnées en autoconsommation avec surplus. Un délai inférieur à la durée de vie des systèmes reliés au réseau (25 ans et plus), ce qui en fait un investissement rentable.
Bien sûr, l’ajout d’une batterie rallonge le retour sur investissement (coût supplémentaire), mais permet d’augmenter son taux d’autoconsommation et de profiter davantage de son énergie solaire le soir. Une façon de vous prévenir des fluctuations du prix de l’électricité et de fixer une partie de votre budget énergie !
En résumé, pour un particulier l’autoconsommation tend à offrir un retour sur investissement plus rapide que la revente totale dans la plupart des cas. Pourquoi ? Parce que le kWh autoconsommé vous épargne un coût de ~0,21 €, alors que le kWh revendu ne vous rapporte plus que 0,04 €.
La revente totale peut encore avoir du sens, mais surtout à partir d’une certaine puissance installée ou pour des profils de consommation atypiques.
Plus l’écart entre le tarif de l’électricité réseau et le tarif de rachat est grand, plus l’autoconsommation est gagnante. Or, cet écart s’est creusé en faveur de l’autoconsommation (tarifs réseau en hausse, rachat en baisse).
Attention cependant : une installation mal dimensionnée peut voir sa rentabilité chuter. Par exemple, si vous surdimensionnez vos panneaux et que 80 % de l’énergie part en surplus vendu à seulement 0,04 €, il aurait mieux valu opter pour un système plus petit ou étudier un usage complémentaire (chauffage aux heures de production solaire, charge d’un véhicule électrique, etc.) pour consommer plus.
👉 D’où l’importance, encore une fois, d’une étude personnalisée pour calibrer au mieux la puissance installée selon vos besoins.
Évolution des coûts et rentabilité
Après ce tour d’horizon technique et économique, résumons les forces et faiblesses de chaque formule connectée au réseau électrique – revente totale d’un côté, autoconsommation de l’autre – et voyons à quels profils d’investisseurs elles correspondent le mieux.
✅ Avantages de l’autoconsommation (avec vente du surplus)
- Réduction de la facture d’électricité : C’est l’argument numéro un. Chaque kWh d’énergie solaire consommé chez vous réduit le coût de l’énergie achetée au prix fort chez votre fournisseur. La baisse de vos factures mensuelles est immédiate (ou un légèrement différée si vous payez un abonnement fixe avec régulation). Ça vous protège aussi en partie des hausses futures des tarifs d’électricité, en rendant votre foyer plus autonome. Autoconsommer vous fait économiser ~0,25 €/kWh, là où vendre rapporte ~0,04 €/kWh, le calcul est vite fait.
- Prime à l’investissement : Bien qu’elle ne fasse que diminuer, en choisissant l’autoconsommation (avec surplus), vous touchez la prime à l’autoconsommation de l’État, ce qui réduit le coût initial de votre installation. Indisponible en revente totale, elle améliore nettement le taux de rentabilité interne de l’installation dès la première année.
- Retour sur investissement accéléré : Comme détaillé plus haut, une installation bien optimisée peut se rentabiliser en moins de 8 ans en autoconsommation, parfois même 6-7 ans dans des configurations bien dimensionnées. C’est environ deux fois plus rapide qu’en revente totale aujourd’hui.
- Impact écologique direct : Ça parait un peu anecdotique, mais psychologiquement, voir sa maison consommer sa « propre électricité » est très valorisant. Bien sûr, vendre sa production est aussi écologique (elle profite au réseau), mais l’autoconsommation renforce la notion d’autonomie énergétique.
- Possibilité d’aller vers l’indépendance énergétique : L’autoconsommation ouvre la porte à des solutions de stockage (batteries domestiques) ou de gestion intelligente (pilotage d’appareils, domotique) pour tendre vers l’autonomie. C’est un avantage pour qui veut se détacher du réseau ou s’assurer une alimentation de secours en cas de panne.
❌ Inconvénients de l’autoconsommation
- Nécessité d’adapter sensiblement ses habitudes de consommation : Pour tirer le meilleur parti de vos panneaux, il faut consommer l’électricité lorsqu’elle est produite (en journée). Ça peut impliquer de modifier un peu son mode de vie : lancer le lave-linge ou le lave-vaisselle plutôt à midi qu’en heures creuses, programmer le chauffe-eau ou la charge du véhicule électrique en début d’après-midi, etc. Pour les personnes absentes toute la journée, ce décalage demande un effort d’organisation (ou l’achat d’appareils programmables). Sans cette optimisation, le taux d’autoconsommation risque d’être faible, et ça réduirait la rentabilité de la future installation.
- Surplus vendu à moindre prix : L’électricité que vous ne consommez pas est vendue, mais on l’a vu, le nouveau tarif du surplus (~0,4 €) est beaucoup plus bas que ce que vous payez pour acheter du courant. C’est tout de même un revenu, mais chaque kWh non utilisé est une opportunité « manquée » d’économiser plus. Si vous n’êtes pas souvent chez vous aux heures solaires, une part importante de votre production partira à ce tarif réduit. Installer une batterie peut pallier ce problème en stockant le surplus pour le soir, mais ça engendre une dépense supplémentaire conséquente.
Si on résume, l’autoconsommation est avantageuse pour tous les propriétaires qui peuvent consommer une partie de leur électricité en journée (ballon d’eau chaude, pompe de piscine, climatisation, lave-vaisselle et lave-linges programmables), ou pour ceux qui souhaitent maximiser le rendement économique en changeant légèrement leurs habitudes.
Elle permet de réduire fortement sa dépendance au réseau et à ses hausses de prix, tout en rentabilisant l’investissement plus rapidement. Toutefois, elle requiert une certaine implication pour l’optimiser et sa pertinence sera moins importante si votre logement est inoccupé aux heures ensoleillées.
✅ Avantages de la revente totale de l’électricité solaire
- Simplicité d’utilisation : Avec la vente totale, aucune question à se poser sur quand consommer votre électricité – vous continuez à vivre normalement, toute votre production part sur le réseau. Vous n’avez pas besoin de modifier vos horaires de consommation ni d’investir dans des dispositifs de stockage. Votre installation fonctionne en arrière-plan comme une petite « centrale personnelle » génératrice de revenu. C’est appréciable pour les personnes qui ne veulent pas adapter leur routine ou qui ont peu de consommation chez elles.
- Revenus fixes et prévisibles : Choisir la vente en totalité, c’est opter pour un revenu stable et garanti sur 20 ans avec une bonne visibilité. Tous les kilowattheures produits seront payés au tarif convenu, quels que soient les fluctuations du marché de l’électricité. C’est donc une source de revenus régulière, semblable à une rente, qui peut compléter par exemple une pension de retraite ou des loyers.
NB : Si vous optez pour un acheteur alternatif toutefois, vous perdrez cet avantage et votre production d’énergie sera revendue selon le prix du marché et le contrat conclut avec l’acheteur alternatif. - Aucune facture d’électricité solaire à gérer : Dans ce cas, vous ne consommez pas votre production, donc vous ne « voyez » jamais votre électricité solaire. Par conséquent, pas besoin de surveiller votre taux d’autoconsommation ni d’équilibrer production et consommation. Vous recevez simplement un paiement pour votre production. Vos factures d’électricité classiques, elles, restent inchangées. Cette séparation complète peut convenir par exemple aux propriétaires bailleurs ou aux résidences secondaires : vous pouvez installer des panneaux sur une maison que vous n’occupez pas, et encaisser de l’argent, sans avoir à vous soucier d’y consommer de l’énergie sur place.
- Adapté aux très faibles besoins du foyer : Si votre maison consomme très peu d’électricité, l’autoconsommation aurait un faible impact sur votre facture. Mais en revente complète, même un foyer peu consommateur peut exploiter son toit au maximum de sa capacité solaire et vendre toute l’énergie produite (surtout dans notre région !). Le solaire devient alors un investissement purement financier, indépendamment de votre profil de consommation, avec une énergie totalement destinée au réseau. Ça peut intéresser certains profils visant un rendement sur un capital, un peu comme on investirait dans des actions ou une épargne à revenus réguliers.
❌ Inconvénients de la revente totale
- Aucun allègement de votre facture électrique : C’est l’inverse de l’autoconsommation – vos panneaux ne vous alimentent pas, donc votre facture d’électricité est la même. Pire, si les tarifs augmentent, vous subirez pleinement ces hausses, sans compensation. Psychologiquement, certains propriétaires le vivent mal sur le long terme, surtout si le tarif de vente est bas comparé au tarif d’achat du courant. Par exemple, vendre à 0,10 €/kWh et racheter son électricité à 0,21 €/kWh peut devenir frustrant. En somme, votre foyer ne bénéficie pas directement de l’énergie verte que vous produisez, ce qui pour beaucoup de gens est un frein.
- Retour sur investissement plus long (pour les petits producteurs) : Aucun doute, l’autoconsommation pour un particulier est souvent plus rentable qu’un investissement en revante totale. À moins que vous ayez de grandes surfaces à couvrir, ou un profil de consommation vraiment atypique, il vous faudra plus de temps pour amortir votre installation en revente totale.
- Pas de prime de l’État : En choisissant la vente totale, on renonce à la prime à l’autoconsommation. C’est un manque à gagner qu’il faut intégrer dans le calcul de rentabilité.
- Dépendance totale aux tarifs d’achat : Ici, votre rentabilité repose entièrement sur le tarif que la régie choisie (EDF OA par exemple) vous verse. Or ce tarif diminue pour les nouveaux contrats, et il n’est pas indexé sur l’inflation une fois votre contrat signé. Ça signifie que 0,10 € de 2025 vaudront peut-être seulement 0,07 € en pouvoir d’achat en 2045. Et si un jour l’État décide de ne plus garantir de tarif subventionné, les nouvelles installations en seraient pénalisés. Pour l’instant, la loi assure encore ce soutien jusqu’à 500 kWc, mais la tendance générale en Europe est de laisser le solaire prendre son essor sans subventions excessives.
Si on résume, la vente totale de l’électricité solaire convient plutôt à des profils qui ne peuvent pas valoriser l’énergie sur place (maison inoccupée le jour, très faible consommation) ou qui recherchent une simplicité maximale et un revenu sûr à long terme, en acceptant une rentabilité modérée. C’est aussi une option pour monétiser une toiture disponible sans se soucier de sa propre consommation.
Pour un propriétaire occupant qui dispose d’une consommation électrique notable, la revente totale pure est souvent moins intéressante aujourd’hui que l’autoconsommation.
Quel choix selon votre profil ?

Comme vous avez pu lire, ça dépend de vos objectifs et de votre profil de consommation.
Vous cherchez avant tout à réduire vos factures d’énergie qui ont grimpé ces dernières années ? L’autoconsommation est faite pour vous.
Vous disposez d’une maison souvent inoccupée en journée (actifs absents, résidence secondaire) et vous ne souhaitez pas investir dans des batteries : La revente ou une autoconsommation avec un faible taux d’usage peut être envisagée, mais il faudra accepter un retour investissement plus long.
Vous hésitez car vous consommez surtout le soir (retour du travail) et le week-end : C’est une situation courante. Deux options : soit vous optez pour l’autoconsommation en ajustant légèrement vos usages (par exemple en programmant le ballon d’eau chaude en journée, en décalant certaines charges d’appareils au week-end en pleine journée, etc.), soit vous envisagez une solution hybride (ajouter une batterie pour couvrir la soirée grâce au surplus stocké la journée.).
Si la batterie n’est pas dans votre budget, une autre approche hybride serait d’installer une puissance plus modérée et de vendre le surplus : vous autoconsommerez tout ce que vous pouvez le week-end, et la semaine le surplus partira en vente.
L’autoconsommation avec vente du surplus est souvent un bon compromis pour les foyers qui ne peuvent pas tout consommer en direct. C’est la configuration la plus répandue aujourd’hui, car elle “coupe la poire en deux” – une partie d’économie, une partie de revenu. Selon vos réglages, vous pourrez tendre plus vers l’un ou l’autre.
Mais dans tous les cas, sachez que chaque maison, chaque foyer a ses spécificités qui influent grandement sur la rentabilité d’un projet solaire en autoconsommation.
Avant de vous lancer, faites réaliser une étude solaire par un professionnel qualifié. C’est généralement gratuit et cela vous permettra de savoir précisément où vous mettez les pieds : combien ça coûte, combien ça rapporte, en combien de temps, et quelles sont les meilleures options pour maximiser vos gains selon votre profil.
Ce travail préparatoire vous aidera à choisir entre revente totale et autoconsommation en toute connaissance de cause, avec des chiffres adaptés à votre maison, votre toit, vos habitudes et votre région – loin des moyennes nationales qui peuvent prêter à confusion.
Découvrez votre potentiel solaire
Ou appelez maintenant au 04.99.63.51.70



